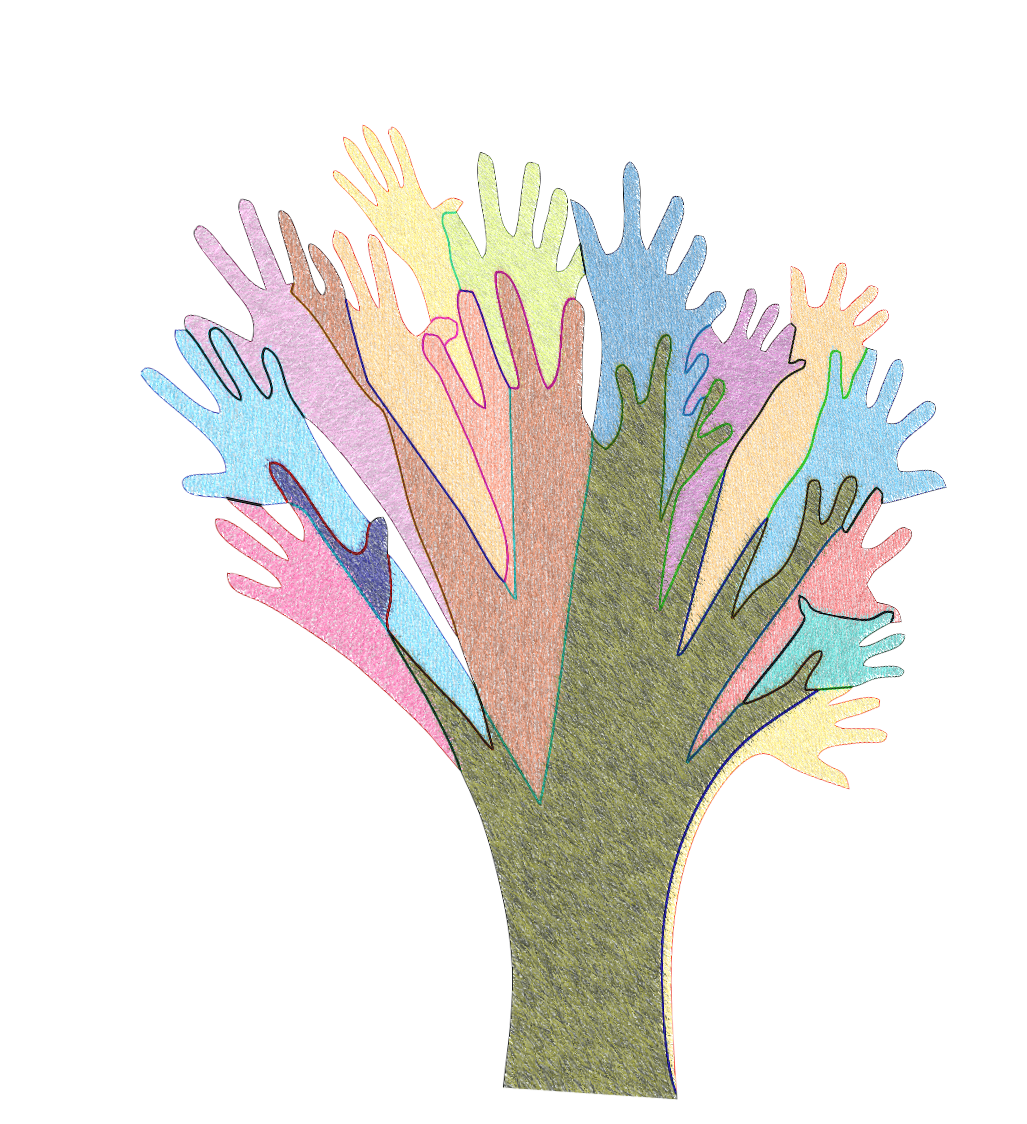Donner de la valeur pour mettre en valeur…
Parmi les contributions volontaires en nature au fonctionnement d’une association, on distingue le bénévolat, les prestations en nature et les dons en nature.
Le bénévolat, c’est quoi ?
Un don parmi d’autres… Le bénévole donne de son temps, de son énergie et de son expérience à la cause d’une association, à la réalisation d’une initiative (le soutien d’un autre qu’il aide !
Le bénévolat est un don et par nature la générosité n‘a ni prix ni mesure… Mais dans une société asservie aux nécessités du marché, la gratuité invisibilise, et, pire parfois, déconsidère et discrédite. L’absence de valeur marchande est signe de vanité.
Ajouter quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros au bilan comptable de l’association peut flatter son image, celle que s’en font ses dirigeants… La valorisation du bénévolat n’est pas un argument de communication dorant la vitrine pour mieux cacher la misère d’une arrière-boutique.
La valorisation du bénévolat pourrait avoir quelques effets délétères dès lors que les valeurs évaluées seraient attachées aux personnes plutôt qu’au service rendu pour le bien commun. Chacun s’investit à la mesure de son engagement, de ses envies et de ses compétences ; pour échapper à toute culpabilisation des contributeurs les plus modestes, la mesure du bénévolat doit échapper aux logiques entrepreneuriales de la performance, de la compétition et de la concurrence pour s’imposer celle de la coopération et du partage.
Le plus important dans la perspective de valorisation du bénévolat reste sans doute la mise en lumière des « coulisses de l’exploit », comme dans toute réalisation, le produit n’est fini qu’après qu’ingrédients, savoirs, instruments et savoir-faire se soient heureusement combinés dans un contexte favorable pour que le processus d’élaboration aille à son terme.
C’est un peu comme si au restaurant s’oubliait tout l’arrière du passe-plat, cuisine, plonge et garde-manger, pour ne goûter qu’au service et passer à la caisse…
Dans les faits
La valorisation du bénévolat forme une part des ressources de l’association.
Aucun texte normatif ne fixe barème ou tarif pour évaluer l’apport du bénévolat. Du plus simple avec l’indexation sur le coût horaire du SMIC et sur le barème fiscal pour les déplacements ou la valeur de remplacement d’une solution facturée (salariat, location…).
La valorisation du bénévolat a pour intérêt premier d’illustrer l’utilité sociale de l’association et sur le plan économique d’abonder la dimension réelle de l’autofinancement face aux contributeurs extérieurs sollicités pour un cofinancement des projets.
C’est également pour percevoir le coût réel des projets qu’il est utile d’y repérer ce qui resterait « coût caché ».
Par exemple pour le projet d’exposition « Art, Littérature et Résistance », le devis imprimeur de sa réalisation s’élève à 3500 euros pour 33 Rollups de 2m x 0,80.
Ce coût n’intègre rien de la conception du produit. Une entreprise d’imprimerie pourrait proposer un service d’assistance à la conception facturé de 100 à 150 euros l’unité, contenus fournis… Ce qui dans le cas d’espèce ajouterait 3000 à 4000 euros à la facture, sans compter le temps passé à la recherche et à la préparation des contenus ni les outils nécessaires. Finalement il n’est pas injuste que l’apport du bénévolat soit intégré pour valoriser la réalisation.
L’exemple des monuments que nous avons réalisés montrerait des différence encore bien plus considérables avec la taille de pierre !
Les deux dimensions intégrées dans la valorisation du bénévolat :
• Quantitative : l’outil de collecte doit être commun à tous les bénévoles et pour tous les objets, simple et transparent et facilement mesurable.
• Qualitative : la valorisation des contributions bénévoles peut être différenciée en référence aux moyens mis en œuvre, compétences, complexité de la tâche, en s’appuyant sur un barème établi collectivement.
Il conviendra donc de discuter au sein de l’association :
• Du bien-fondé de la mise en œuvre de la valorisation du bénévolat
• De ses modalités d’application*
• De l’évaluation des contributions en nature
• Des l’évaluation des dons en nature
Outre les effets sur la présentation des comptes de l’association, ces mesures peuvent permettre d’agir sur les déclarations fiscales des bénévoles :
Au chapitre des « Dons de particuliers » l’article 200 du code général des impôts (CGI) élargit le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu de 66 % prévue pour les dons à certaines contributions volontaires : Frais des bénévoles : les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d’impôt pour les frais qu’ils engagent ont été précisées dans l’instruction fiscale BOI-IR – RICI -250-20-n°180.10 D’une part, l’association doit répondre aux conditions définies à l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire avoir pour objet l’un de ceux limitativement énumérés audit article et être d’intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06, et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. D’autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés, si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l’activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l’association et l’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Il est toutefois admis que les frais de véhicule automobile soient évalués forfaitairement en fonction d’un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification.
*Certains utilisent le SMIC chargé et assorti de coefficients de pondération en fonction d’une échelle de « responsabilité » du bénévole ou du niveau d’expertise de la compétence mise en œuvre (juridique, communication, gestion, etc.). Catégories et coefficients doivent être débattus, fixés et portés à la connaissance de tous.
La valorisation du bénévolat